Les rapports de classes sont extrêmement violents au Congo. L’État post-colonial congolais est le produit d’un mélange forcé entre plusieurs cultures vivantes et multiples, tout cela dans l’optique de servir un idéal suprémaciste blanc, tirant sa “légitimité” de notre supposée “infériorité”. Nos essences sont mises en conflit, obligées d’évoluer dans un cadre qui nous a été imposé et dans lequel chacun cherche à trouver sa place.
Le capitalisme y est particulièrement sauvage, et ses aspects les plus négatifs sont accentués par la persistance de divisions ethniques qui morcellent la société en petits groupes dont les intérêts semblent peu concordants en surface. Cette réalité se manifeste à la fois dans l’espace public et privé, où les forces héritées de la colonisation sont à l’œuvre.
Le classisme exerce toute sa pression et se manifeste parfois purement et simplement par un déni de l’humanité des plus pauvres, dont la valeur est dérisoire pour les privilégiés. Il est important de noter que ce texte n’est pas une étude sociologique, mais plutôt une réflexion personnelle sur une expérience vécue.
J’ai intégré le Lycée Français Saint-Exupéry à l’âge de quatre ans. À l’époque, ma mère venait de s’installer à Brazzaville. Mes parents étant séparés, je ne l’ai rejointe qu’après la rentrée. Les moments les plus mémorables de cette période de ma vie sont ceux passés à l’avenue de France à Poto-Poto. Pendant longtemps, j’ai habité dans la maison de ma grand-mère, qui se composait de trois « appartements » adjacents.
C’est dans cette bâtisse que j’ai grandi, non loin du Madoukou au bord de la Pointe Hollandaise. Aujourd’hui, il y a des murs et une porte d’entrée, mais à l’époque, c’était une cour ouverte qui m’a permis de vivre une enfance des plus ordinaires. Très rapidement, je me suis adapté ; je parlais lingala avant même d’arriver, ce qui m’a facilité l’intégration avec les autres enfants du quartier.
C’était un changement radical. J’étais déjà venu pour les vacances à l’âge de deux ans, mais vivre au pays aussi longtemps, je ne l’avais jamais fait. Sur le plan racial, c’était une expérience différente. Avant de m’installer à Brazzaville, j’avais eu le malheur d’être le seul Noir de mon école. Cette expérience a été très marquante. Le racisme commence très tôt, bien trop tôt. Mes premiers souvenirs d’école à ‘St-Ex’ remontent à la moyenne section.
Je peux distinguer trois catégories d’élèves à Saint-Exupéry. Tout d’abord, il y a les enfants d’expatriés français. Souvent, leurs parents ne paient pas les frais de scolarité. La plupart travaillent pour l’État français ou des entreprises françaises. Étant en terrain conquis, tout leur est offert. Il est impossible de les associer à un revenu type, mais il est évident qu’ils ne sont pas à plaindre. Ensuite, il y a les enfants de la petite bourgeoisie congolaise, à laquelle je m’identifie partiellement. Ce groupe est composé tant de personnes nées en France que de personnes nées au Congo.
Pour ce qui est des professions des parents, il s’agit d’un mélange hétéroclite de hauts fonctionnaires, de militaires ou d’autres membres importants de l’appareil d’État. Certains ont des parents issus du secteur privé, comme ce fut le cas pour moi pendant longtemps. Enfin, il y a les élèves dont les parents travaillent pour l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et qui habitent principalement dans un quartier qui leur est propre, dans le sud de la ville, et qui bénéficient pour la plupart, encore une fois, d’une situation confortable. Le reste est plus ‘complexe’, mais ce sont les trois groupes les plus importants.
Ce n’est qu’en CE2 que la distinction a réellement pris forme. Alors que nous avions à peine 7 ou 8 ans, nous avions pris l’habitude de comparer nos vies en utilisant la “richesse de nos parents”. C’est ainsi qu’un sentiment qui m’était alors inconnu s’est progressivement immiscé dans mon quotidien : la honte.
Venir en taxi, c’était honteux, la preuve que vous étiez pauvre, que malgré tout, vous n’apparteniez pas à ce monde. C’était ma honte pendant de nombreuses années. “Mon père conduit ceci, mon père conduit cela.” Ces phrases faisaient partie de la routine. Je n’aimais pas être déposé devant l’école, préférant marcher plus longtemps quitte à arriver en retard.
Avec l’âge et le recul, il est évident que ce comportement était ridicule. À l’échelle du pays, très peu de gens peuvent se permettre d’avoir un chauffeur. J’étais déjà extrêmement privilégié par rapport à la majorité des Congolais, mais à cet âge-là, ce n’était pas ce qui comptait. La pression du groupe était trop grande.
La voiture n’était pas tout, il y avait aussi les vêtements, les téléphones et tous les autres éléments matériels susceptibles de dégager une quelconque supériorité. Qui porte un vrai maillot ? Qui porte de vraies chaussures ? Qui a tel téléphone ? Qui a un vrai téléphone ? Le mépris de classe était présent en permanence. Chaque jour, c’était la même rengaine, nous passions notre temps à nous surveiller mutuellement, à l’affût du moindre détail qui pourrait vous exclure. Les plus doués se protégeaient avec l’humour, les autres supportaient stoïquement.
Ce fut ainsi jusqu’à ma dernière année à Brazzaville, c’est-à-dire ma seconde. Entre-temps, beaucoup de choses avaient changé pour moi sur le plan financier. Je n’habitais plus chez ma grand-mère, ma mère avait changé de poste, et donc de revenu, et mon père s’était enfin installé à Brazzaville. Ce que je veux dire, c’est qu’au niveau du compte en banque, ce n’était plus comme en CE2.
Il y avait toujours une distance entre moi et les plus fortunés, mais j’étais très à l’aise financièrement. Il faut dire que dans un pays pauvre comme le Congo, parler de transfuge de classe serait dérisoire tant le niveau de vie est bas. La distinction entre les élèves était toujours présente, mais elle devenait plus subtile. Chacun était conscient de la position de l’autre, et cela suffisait pour établir des distances.
Cette habitude reflète un environnement particulier, celui de la petite bourgeoisie congolaise. Les comportements que nous avions étaient caractéristiques de cette classe sociale, surtout dans le contexte de la gabegie de l’État postcolonial congolais. Le culte de l’apparence et de l’argent y est très prononcé.
Plus que la qualité de l’éducation, pour certaines personnes, mettre leurs enfants à Saint-Ex est une question de prestige. Dans un cadre comme celui-ci, la culture de l’excès règne en maître. C’est ainsi qu’un jour, un élève est venu à l’école avec 800 000 FCFA juste parce qu’il en avait les moyens. Plus de 1000 euros dans les poches, simplement pour montrer qu’il n’était pas n’importe qui, et qu’il en était capable.
Je n’ai jamais atteint ce niveau d’ostentation, d’abord parce que c’était absurde, mais surtout parce que je n’ai jamais eu accès à ce genre d’argent. Cependant, avec le recul, je me suis rendu compte de la vanité de certains de mes comportements. Comme vous le savez maintenant, pendant longtemps, c’est en taxi que je venais à l’école.
Au fil du temps, ma mère a pu s’acheter une voiture, une Toyota Corolla ; ce modèle est surnommé la “Benoît XVI” au Congo. Malgré les efforts de ma mère, ce n’était pas suffisant. Ce n’était pas une “V8”, une “Prado” ou encore une “Rav4” (que nous aurions plus tard). Celui qui avait une bonne voiture, c’était mon père.
Grâce à son travail, il avait une Toyota Hilux. Parfois, je restais chez lui, donc le chauffeur me déposait à l’école. Un jour après les cours, j’ai accompagné deux filles de ma classe pour acheter des viennoiseries ou des glaces (je ne me souviens plus très bien) dans un restaurant libanais (Noura ou La Mandarine) avenue Foch. Je ne les appréciais pas particulièrement, pas du tout d’ailleurs. Je voulais juste leur prouver que j’avais de la valeur, et que cette valeur était financière. Cet événement s’inscrit dans une série d’actions similaires.
Dans ce contexte, certaines paroles révèlent un profond malaise présent dans la société congolaise. J’avais l’habitude d’entendre cette phrase : « Quand tu seras quelqu’un (ministre, président, etc.), il ne faudra pas m’oublier. » Elle illustre une mentalité alimentée par la stagnation du Congo. Les destins semblent tout tracés, la reproduction sociale n’est qu’un aspect parmi d’autres du système.
Ici, il ne s’agit pas de reconnaître des capacités ou une intelligence supposées ou confirmées, mais un statut, une image, qui correspond à une routine dont il est impossible de s’extraire. Les mêmes dirigeants font tout leur possible pour s’accorder des faveurs.
Il existait aussi un mépris envers les Congolais. Tout ce qui rappelait la réalité du pays dans lequel nous vivions était dévalorisé, que ce soit l’accent ou les lieux de villégiature. Celui qui n’était jamais allé en France était considéré comme “inférieur” à nous. Il ne connaissait pas l’Occident, l’Europe, donc sa valeur était moindre. Il ne fallait pas parler, se mouvoir ou s’habiller comme un “blédard”. Nos cultures étaient pour la plupart tournées en dérision, à l’exception de la musique pour certains.
C’était troublant de se retrouver face à des “bana poto” dont la nature même de leur identité leur était étrangère. Ayant eu le privilège de parents soucieux de me transmettre l’héritage culturel familial, la déconnexion de certains m’attristait. Les enseignants et les autres membres du personnel de l’école en faisaient les frais. Il y avait une différence de traitement de la part des élèves, mais aussi de la part de l’administration.
Dans l’intimité, la situation était similaire. Les domestiques n’étaient que cela : des serviteurs et rien de plus. Le mépris se manifestait parfois par des insultes, et les brimades étaient fréquentes, tellement habituelles qu’elles passaient inaperçues en public. Chacun avait son propre monde, et le respect n’était pas universel. Ma mère m’a toujours encouragé à être proche d’eux.
Elle qui avait été cette fille qui ne faisait que servir, traitée sans la moindre considération ni reconnaissance. Je vous avoue que cela n’a pas empêché les débordements, mais j’étais assez troublé par le mépris dont certains pouvaient faire preuve. Il y a des foyers où les domestiques ne peuvent même pas s’asseoir sur le canapé, voire accéder au salon.
La concession coloniale n’a jamais vraiment disparu. Les élites autochtones servent la métropole et ses agents, tandis que la masse subit les conséquences de soixante ans d’exploitation. Un jour, lors d’une conversation avec un employé congolais de l’école, l’un de mes professeurs a déclaré ceci : ‘Aujourd’hui, il y a beaucoup de Chinois, mais ce pays appartient aux Blancs.’ Cette phrase m’a choqué et est symptomatique du sentiment de supériorité ressenti par de nombreux expatriés pour qui l’Afrique reste un bien qui leur est dû.
Formés dans leurs écoles, nous les laissons se comporter comme des maîtres dans leurs clubs de tennis où ils se retrouvent en toute convivialité, dans un entre-soi total, celui des personnes bien nées. Par l’intermédiaire du lycée, de l’Institut Français du Congo (IFC) et des divers commerces qu’ils possèdent, ils étendent leur influence jusqu’à devenir incontournables. Nous évoluons dans leur écosystème, où que nous allions.
Aujourd’hui, il est clair que je ne partage plus les vues que j’ai pu avoir par le passé. L’amour-propre empêche de se sentir inférieur. Ce que j’ai souligné ici n’est qu’un aspect de mon expérience dans un lycée français en Afrique. La distinction se fait selon plusieurs facteurs, notamment nationaux, mais j’ai choisi de mettre en lumière l’aspect financier, car il me semble le plus important.
Tant que nos États seront dirigés par des dirigeants corrompus, nos systèmes éducatifs resteront médiocres. En inscrivant leurs enfants dans cette école, mes parents ont fait un choix. Je ne les blâme pas, bien au contraire, ils ont fait ce qu’ils pensaient être le mieux pour leurs fils. Tout n’est pas à rejeter, mais il faut avoir la lucidité de comprendre ce que représente l’existence de ce genre d’institution.
À bien des égards, cette école est une relique du système colonial. Sur le plan idéologique, nous y apprenions la ‘supériorité’ de la civilisation occidentale en plein milieu de l’Afrique. Comme je l’ai mentionné précédemment, ces écoles représentent les pires excès de la société postcoloniale. Le matérialisme qui prédomine dans la société congolaise découle de considérations superficielles importées d’une Europe qui constitue souvent le modèle ultime de ce qui est bon, beau et même humain.
Nos sociétés sont profondément aliénées, détruites par des dirigeants dont l’action se limite à la simple imitation, et elles regorgent de contrastes saisissants qu’il est impossible d’ignorer une fois que l’on constate la gravité des faits. Plus longtemps j’ai fréquenté Saint-Ex, plus je me suis éloigné du Congo au quotidien.
C’est parce que je connais les deux environnements, la distance qui les sépare, que je suis d’autant plus virulent dans ma critique du pouvoir. Je sais à quel point une prise de conscience est nécessaire pour que les choses changent. Ce pays n’appartient pas à un seul homme, un seul clan ou une seule ethnie.
La construction d’une nation passe nécessairement par l’éducation. Laissée à l’abandon en raison de l’indifférence des dirigeants congolais, cette négligence pousse l’indécence à son paroxysme lorsque ces mêmes personnes, qui pénalisent délibérément des générations entières de jeunes Congolais, inscrivent leurs propres enfants dans des écoles comme celle que j’ai fréquentée.
Ils garantissent ainsi l’avenir de leurs propres enfants tout en perpétuant le système qui est aujourd’hui au cœur de la faillite de cet État. Lorsque les parents tombent malades, ils se rendent à l’hôpital Netcare et non au CHU vétuste, en raison de leur inaction, où le peuple meurt dans des conditions insalubres, pires que celles où même les bêtes ne pousseraient pas leur dernier soupir.
Les écoles manquent de tables, les hôpitaux de respirateurs. Dans les pages des Dépêches de Brazzaville, le journal au service du pouvoir, on célèbre la remise des prix d’excellence. Mis sur un piédestal, comme les ‘évolués’ de leur époque, ces élèves symbolisent la réussite du crime colonial.
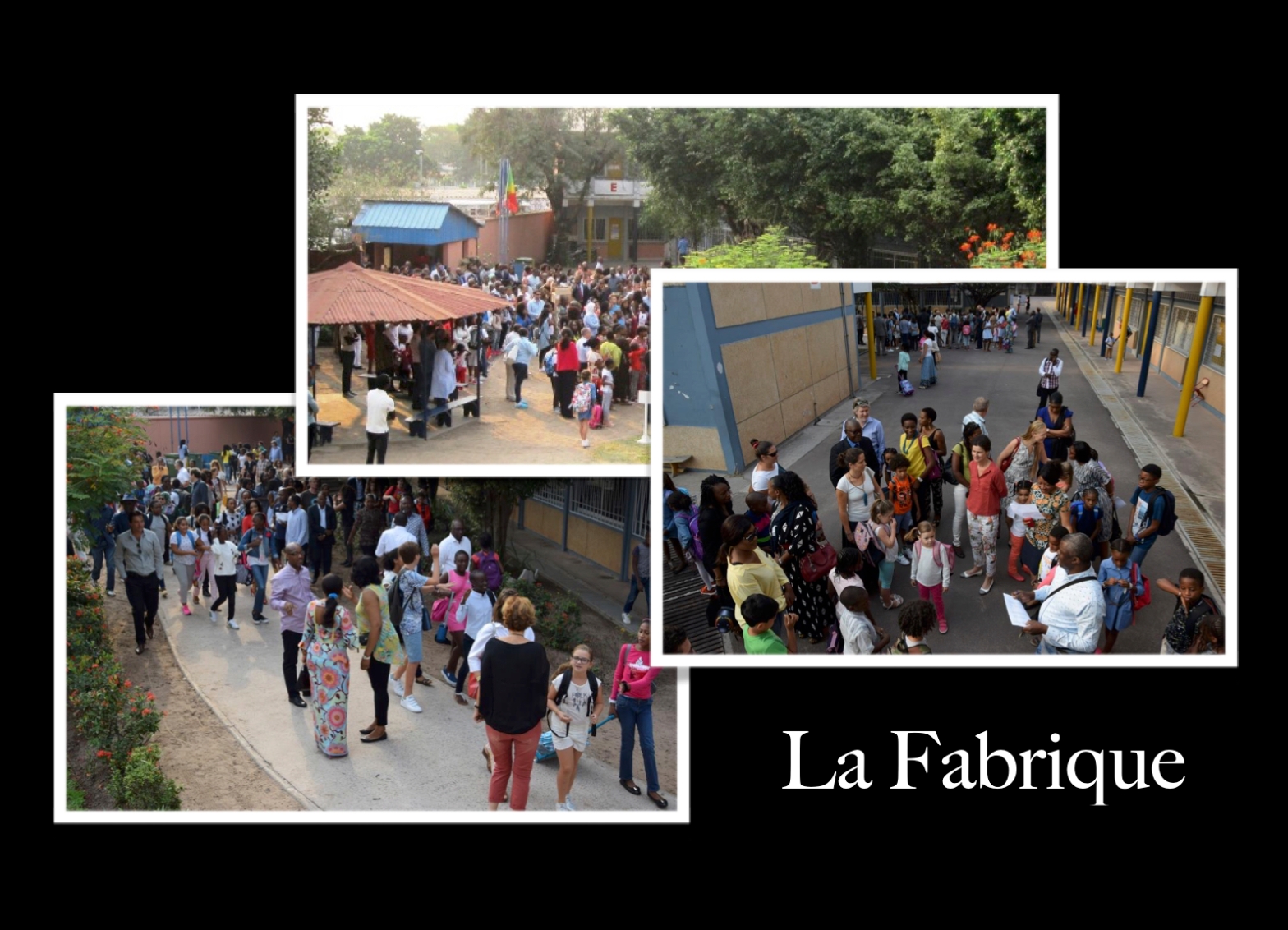
J’ai apprécié lire cet article. Il reflète une réalité que tu as très bien décrit.
Mon copain était également dans un lycée français à Abidjan, les attitudes sont les mêmes.
J’aimeAimé par 1 personne